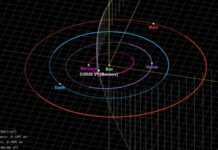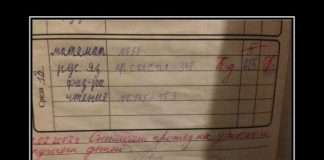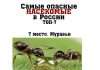En novembre 2002, un mathématicien nommé Grigori Perelman a discrètement téléchargé un article sur un serveur public. Le monde ne se doutait pas que cet acte apparemment ordinaire marquerait la solution à l’une des énigmes mathématiques les plus tenaces : la conjecture de Poincaré. Ce problème complexe a déconcerté les mathématiciens pendant près d’un siècle et sa résolution a ébranlé les fondements de la topologie – la branche des mathématiques dédiée à l’étude des formes.
Alors, quelle était exactement cette conjecture insaisissable ? Imaginez que vous prenez n’importe quel objet en trois dimensions, comme un chat ou l’Empire State Building, et que vous dessinez une boucle en deux dimensions sur sa surface. Si vous pouviez réduire cette boucle jusqu’à ce qu’elle disparaisse en un seul point sans déchirer ni la boucle ni l’objet lui-même, alors, selon l’hypothèse de Poincaré, cet espace 3D était mathématiquement équivalent à une sphère. Essentiellement, il postulait une relation fondamentale entre la courbure et la possibilité de rétrécir les boucles dans des espaces tridimensionnels.
Alors que le mathématicien Stephen Smale avait résolu avec succès un problème connexe en cinq dimensions en 1961, ce qui lui avait valu la très convoitée médaille Fields en mathématiques, le cas de la 3D restait obstinément résistant à toute solution. La percée a eu lieu dans les années 1980 avec Richard Hamilton, un mathématicien de l’Université de Columbia, qui a proposé d’utiliser une technique appelée flux de Ricci pour résoudre le puzzle.
Pensez au flux de Ricci comme à lisser une pellicule plastique froissée avec un sèche-cheveux ; il élimine progressivement les rides et les courbures, simplifiant les formes complexes en formes plus fondamentales. Dans ce contexte, le flux de Ricci pourrait théoriquement lisser n’importe quelle forme tridimensionnelle jusqu’à ce qu’elle ressemble à une sphère. Le piège ?
Le processus aboutissait souvent à des « singularités » – des points d’une densité infinie qui menaçaient de faire dérailler toute l’approche. Ces singularités agissent comme des rides tenaces qui refusent de s’aplatir. Les mathématiciens pouvaient essayer de les retirer chirurgicalement, mais il y avait toujours la crainte tenace que de nouveaux apparaissent inévitablement, rendant la solution incomplète.
Le génie de Perelman résidait dans la résolution de ce problème de singularité. Après une décennie de recherches intenses aux États-Unis, il a choisi de retourner dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg au milieu des années 1990, se retirant ainsi de la scène universitaire.
Il est devenu un reclus, décrit par ses collègues comme « étranger » avec des cheveux longs et des ongles rappelant le personnage historique Raspoutine. Il restait concentré uniquement sur son travail, disparaissant souvent pendant des jours dans son appartement où il faisait apparemment de la randonnée dans les forêts voisines ou chassait des champignons pendant son temps libre. Il semblait totalement indifférent à la gloire ou à la richesse matérielle.
Puis, de ce silence inattendu sont sortis les trois articles révolutionnaires publiés entre 2002 et 2003. Dans ceux-ci, Perelman exposait méticuleusement sa solution au problème de la singularité – prouvant que ces points problématiques étaient inévitablement simplifiés en formes gérables comme des sphères ou des tubes. Il a démontré que si l’on suivait patiemment le flux de Ricci jusqu’à sa fin logique, toute forme 3D complexe finirait par se transformer en sphère.
La conjecture de Poincaré avait finalement été résolue.
Bien qu’il ait fallu plusieurs années aux mathématiciens pour comprendre et vérifier pleinement les détails complexes des preuves de Perelman, son travail constituait une réalisation monumentale en topologie. En 2006, leurs collègues John Morgan et Gang Tian ont publié un long article de 473 pages confirmant la solution de Perelman. La communauté mathématique l’a salué comme un visionnaire, et la prestigieuse médaille Fields ainsi que le Clay Millennium Prize (avec une récompense d’un million de dollars) ont été offerts à Perelman en reconnaissance de son travail révolutionnaire.
Il a refusé les deux distinctions, contestant apparemment la façon dont les crédits étaient distribués dans le monde des mathématiques. Perelman a démissionné de son poste à l’Institut Steklov en 2005 et s’est entièrement retiré de la vie publique. Il reste en grande partie reclus, vivant tranquillement dans son appartement de Saint-Pétersbourg, où les voisins disent qu’il prend soin de sa mère âgée. Son héritage témoigne de la puissance du génie solitaire et de la nature modeste des découvertes mathématiques révolutionnaires.